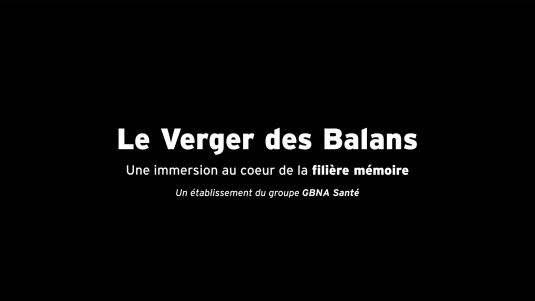- Infosanté
Maladie d’Alzheimer : rencontre avec le Dr Éric Dumas, gériatre au Verger des Balans.
Pour le Dr Éric Dumas, gériatre au Verger des Balans et vice-président de la Fédération des Centres Mémoire, les immunothérapies anti-amyloïdes peuvent représenter une nouvelle stratégie thérapeutique à un stade précoce de la maladie
Plus de vingt ans après l’approbation des derniers traitements, un nouvel espoir s’ouvre pour les patients atteints de maladie d’Alzheimer : l’immunothérapie anti-amyloïde. Le Dr Éric Dumas, gériatre au Verger des Balans (filière de soins pour patients atteints de maladies neurocognitives et établissement du groupe GBNA Santé) et vice-président de la Fédération des Centres Mémoire, nous partage une avancée signifiante qui pourrait ralentir la progression de la maladie et préserver plus longtemps l’autonomie des patients. Ces traitements utilisent des anticorps capables de cibler et d’éliminer les plaques amyloïdes qui s’accumulent dans le cerveau et altèrent la mémoire, une avancée très attendue par les patients et leurs familles.
Un changement de paradigme dans le diagnostic et la prise en soin des patients
L’arrivée possible des immunothérapies anti-amyloïdes implique un changement notable dans l’approche diagnostique et modifie également le paradigme de la prise en soin. Jusqu’ici, le diagnostic intervenait souvent tardivement, lorsque les symptômes étaient déjà bien installés. Avec ces nouveaux traitements, un diagnostic plus précoce, basé sur l’évaluation clinique associée à la détection de lésions amyloïdes grâce à des biomarqueurs (identifiables par IRM, PET scan, ponction lombaire ou, à terme, tests sanguins) sera nécessaire.
Le Dr Éric Dumas, gériatre, expert de la maladie d’Alzheimer au centre de soins du Verger des Balans souligne l’importance de cette étape :
-
« Pour la première fois, un traitement agit directement sur l’un des mécanismes de cette maladie multifactorielle. Il faut être clair, ce n’est pas la promesse d’une guérison mais les études cliniques montrent un ralentissement de 27 % du déclin cognitif, pour la première immunothérapie autorisée en Europe. C’est une avancée scientifique notable, attendue depuis deux décennies. Depuis, une seconde immunothérapie a été autorisée cet été en Europe par le CHMP (Comité des Médicaments à Usage Humain) ».
Dr Éric Dumas
Gériatre, expert de la maladie d’Alzheimer au centre de soins du Verger des Balans
Les bénéfices attendus ne concernent pas uniquement les patients. En ralentissant la perte d’autonomie, ces traitements pourront aussi avoir un impact direct sur la vie des aidants, souvent les premiers soutiens au quotidien. Les données des essais montrent des effets sur la réduction de la charge et de l’épuisement ressentis par les proches.
« Derrière chaque malade, il y a une famille. Préserver un peu plus longtemps l’autonomie, c’est préserver du temps et du lien », souligne le Dr Dumas.

Une organisation française déjà mobilisée, dans un cadre encore en discussion
Sur le plan organisationnel, la France se prépare à l’arrivée de ces thérapies. La Fédération des Centres Mémoire a publié des recommandations dès 2024 autant en termes de diagnostic précoce de la maladie que d’indication et de suivi de ces traitements. Elle préconise un cadre rigoureux : prescription initiale limitée aux centres mémoire hospitaliers formés à la prescription et à la dispensation de ces traitements, registres nationaux (déjà prévus dans l’autorisation européenne) pour suivre les patients, protocoles de pharmacovigilance, et surveillance rapprochée par imagerie (jusqu’à cinq IRM par an) afin de détecter de possibles effets secondaires liés à l’élimination des plaques amyloïdes.
Depuis deux ans, des groupes de travail de la Fédération des Centres Mémoire s’attachent d’ailleurs à structurer cette filière de santé autour de l’immunothérapie, en anticipant les besoins logistiques et médicaux : imagerie, examens diagnostiques, organisation des parcours.
« Ces traitements représentent une arme supplémentaire contre la maladie », et leurs coûts doivent être mis en regard de ceux que représente la prise en soin d’un patient à un stade avancé. La mobilisation française est réelle, même si le cadre définitif d’utilisation reste encore en discussion.
En septembre dernier, la Commission de la Transparence de la Haute Autorité de Santé (HAS) n’a pas accordé d’autorisation d’accès précoce en France pour la première immunothérapie autorisée en Europe, contrairement à d’autres pays de l’Union Européenne. Ce refus de procédure accélérée ne veut pas pour autant dire que le traitement est définitivement rejeté en France. L’accès des patients au traitement sera donc retardé.
Cette décision illustre également les exigences élevées en matière d’évaluation et de sécurité. Pour autant, elle ne remet pas en cause l’intérêt scientifique des immunothérapies, et souligne la nécessité de poursuivre la préparation des équipes médicales et des structures de soins afin d’être prêtes à les intégrer dès que possible.
Si l’immunothérapie constitue une réelle avancée, elle doit être appréhendée avec prudence. Les traitements sont réservés aux stades précoces, avec des contre-indications limitant la prescription à certains patients seulement et ne permettent pas de guérir la maladie. Leur efficacité à long terme reste à confirmer, notamment sur la capacité à modifier durablement l’évolution de la pathologie.
« L’enthousiasme doit aller de pair avec la vigilance », rappelle le Dr Dumas. « Ces médicaments offrent une nouvelle arme thérapeutique, parmi une offre de soin médico-psycho-sociale, mais leur utilisation doit être encadrée et rigoureusement suivie. »
-
Par ailleurs, la recherche ne se limite pas à la protéine amyloïde. Elle explore également d’autres pistes, comme la voie de la protéine TAU, impliquée dans la dégénérescence des neurones, ou encore le rôle de la neuro-inflammation dans l’évolution de la maladie. Ces travaux concernent aussi les autres maladies neurocognitives.
Dr Éric Dumas
Gériatre, expert de la maladie d’Alzheimer au centre de soins du Verger des Balans